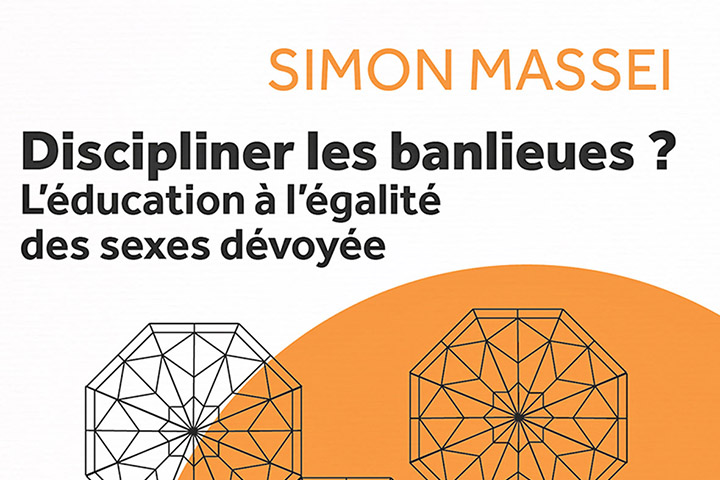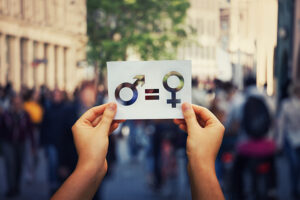Interview de Bruno Cremonesi
Simon Massei questionne les politiques d’éducation à l’égalité entre les sexes. Il a réalisé pendant de nombreuses années une étude approfondie des interventions menées dans les classes sur l’éducation à la sexualité ou sur les questions d’égalité, notamment par des structures professionnelles. Il montre toute l’importance des usages scolaires du discours égalitaire entre les sexes en France, sur l’histoire du mouvement des femmes, sur la sexualité ou sur le consentement. Cependant, son ouvrage interroge aussi le rôle que jouent ces séances dans la reproduction et la recomposition des rapports de classe et de race à travers les usages socialement différenciés dont elles font l’objet de la part des élèves.
Bruno CREMONESI : Vous identifiez plusieurs types de personnes qui réalisent ces séances avec les élèves. Pourriez-vous présenter leurs principales caractéristiques ?
Simon MASSEI : Il me semblait important, en effet, de distinguer plusieurs profils d’intervenantes pour montrer qu’elles ne composent pas toutes de la même manière avec le mandat « disciplinaire » qu’on leur attribue, pour faire ici référence au titre du livre. J’ai distingué trois grands profils parmi les personnes qui animent ces séances. D’abord celles que j’ai nommées les militantes, souvent issues du féminisme associatif, dont l’engagement dans le secteur de l’éducation à l’égalité des sexes à l’école prolonge souvent un engagement politique. Elles parlent ouvertement de sexisme et de domination en classe, cherchent à faire réfléchir les élèves et se tiennent à distance du cadre scolaire pour favoriser la parole libre. Les éducatrices viennent plutôt du monde de l’animation ou de l’éducation populaire. Elles ont une approche plus institutionnelle et refusent toute logique militante. Elles parlent de respect, de vivre-ensemble et accordent beaucoup d’importance au cadre, à la discipline et même à la posture des élèves pendant les séances. Enfin, les mercenaires forment un groupe plus hétérogène : juristes, psychologues, comédiennes… Elles ont découvert ces questions par leur travail, et souvent plus tardivement que les militantes, par exemple. Leur discours est aussi moins ouvertement politisé : elles parlent d’égalité à travers des notions comme le girl power ou l’empowerment, dans une logique plus technique et professionnelle que directement militante.
Éduquer à l’égalité ne suffit pas : ces séances révèlent autant qu’elles transforment les rapports sociaux qu’elles prétendent corriger
B. C. : L’un des constats que vous faites est : « L’attitude des garçons des milieux populaires traduit finalement plus leur capacité à apprendre et à réciter sans erreur le discours sur l’égalité que leurs convictions intimes. » Pouvez-vous préciser ?
S. M. : Ce que j’essaie de montrer, c’est que la réception du discours égalitaire par les élèves de classes populaires est profondément façonnée par les rapports de classe, de genre et de race. Confrontés à des références et à un langage éloigné de leurs univers sociaux, beaucoup peinent à saisir le sens politique du message, qui leur paraît abstrait ou moralisateur. Les garçons, en particulier les racisés, répondent donc souvent par l’humour, par la provocation ou par le silence : autant de façons de préserver leur appartenance au groupe et de résister à un cadre scolaire perçu comme distant et stigmatisant. Cette posture, que je décris comme une forme de « bouffonisation », en empruntant un concept du sociologue Erving Goffman, leur permet d’exister dans la séance tout en se protégeant du jugement scolaire. Les filles, plus proches des attentes scolaires, adoptent une attitude plus conforme, mais interprètent l’égalité à travers une morale populaire du respect et de la décence, qui limite la portée féministe du message. Mais l’ensemble révèle moins un rejet de l’égalité qu’une appropriation socialement située du discours qui la promeut.
B. C. : L’une des intentions de votre ouvrage est votre volonté de comprendre la racialisation du sexisme. C’est-à-dire ?

S. M. : Quand je parle de « racialisation du sexisme » (notion que j’emprunte à l’anthropologue Christelle Hamel), je cherche à comprendre comment le sexisme en est venu à être perçu comme un problème propre aux classes populaires racisées. Autrement dit, pourquoi et comment des politiques publiques censées promouvoir l’égalité entre les sexes ciblent prioritairement les élèves des banlieues pauvres, comme si le sexisme se concentrait dans ces territoires. Mon enquête montre que ce ciblage tient moins à une réalité empirique du sexisme qu’à un ensemble de logiques administratives, politiques et médiatiques : les financements passent par la Politique de la ville, les discours publics associent depuis longtemps islam, banlieue et domination masculine. En fin de compte, on assiste à une double opération : le sexisme est à la fois dépolitisé – réduit à une question de comportements individuels – et racialisé, c’est-à-dire renvoyé à « l’Autre », à celles et ceux des quartiers populaires issus de l’immigration.
Derrière le discours égalitaire, se joue une recomposition des frontières de classe, de genre et de race dans l’espace scolaire
B. C. : Vous parlez de la construction du problème musulman… Que voulez-vous dire par là ?
S. M . : Cette partie de l’ouvrage s’appuie largement sur les analyses des sociologues Marwan Mohammed et Abdellali Hajjat. Je me contente pour ma part de montrer comment cette construction du problème musulman passe aussi par les politiques scolaires. Depuis les années 1980, l’islam a été progressivement transformé en problème public. Ce glissement part du « problème algérien » après la décolonisation, devient dans les années 1980 un « problème de l’immigration », puis se reformule en termes d’« intégration » et de « laïcité ». L’affaire du voile de Creil, en 1989, cristallise ce processus : on y associe désormais islam, sexisme et menace pour la République. Ce cadrage est repris par les médias, le champ politique et une partie des mouvements féministes. À partir de là, les questions de genre deviennent un prisme privilégié pour parler d’islam et, inversement, les jeunes musulmans des quartiers populaires sont perçus comme les figures emblématiques du sexisme. C’est ce processus qu’on nomme la « construction du problème musulman ». C’est une manière de dire que ce n’est pas un fait brut, mais une production politique et sociale.