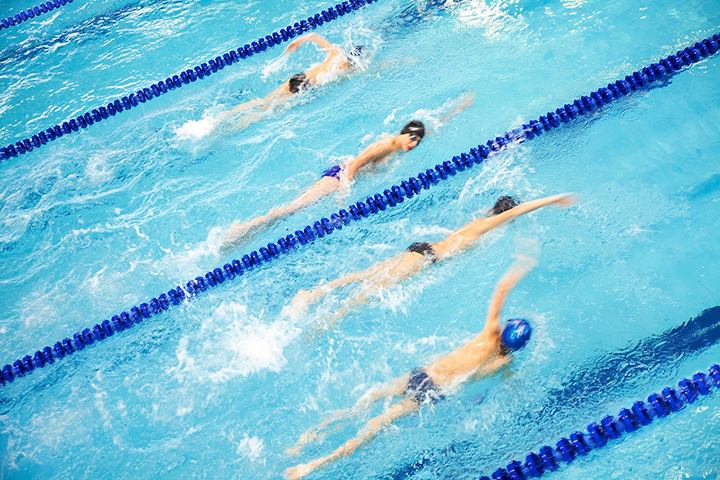Dans la représentation spontanée des enseignant·es, des familles, des élèves, la notion de savoir ne s’applique pas à l’EPS. Dans le meilleur des cas, le terme est accolé à un autre, savoir-faire par exemple. Depuis un certain nombre d’années, la notion de compétence a été substituée dans la littérature pédagogique et institutionnelle. Or, le SNEP et son centre d’étude « EPS et société » utilisent régulièrement ce mot pour identifier ce qu’il y a à apprendre.
Subtilité de langage ? Quel intérêt ?
Le savoir, ou les savoirs, ne font pas partie du langage officiel de l’EPS. Bien sûr on retrouve ici ou là l’utilisation du terme mais ce n’est absolument pas central. Il suffit de parcourir tous les programmes scolaires, les textes sur l’évaluation depuis ces 40 dernières années pour s’en convaincre. Dans le meilleur des cas, il est utilisé comme verbe, accolé à un autre : savoir s’entrainer, savoir nager, savoir rouler… A contrario, dans ces textes, depuis 1996 avec les programmes collège, c’est la notion de compétence qui est le mot-clé, utilisé de façon abondante, voire exagérée. Si l’on compare par exemple avec les programmes des autres disciplines, même si on sent un peu les effets de « l’offensive » des compétences en milieu scolaire, il n’y a aucune mesure avec cette surutilisation du mot en EPS. Faut-il y voir une assise théorique et pratique forte ou juste une allégeance à la mode du moment ? Ayant suivi de près toutes les étapes institutionnelles depuis 1981, on aurait plutôt tendance à privilégier la seconde hypothèse.
Mais il serait naïf de penser qu’il s’agit juste d’une question de mots, en tout cas jusqu’à un certain niveau. Au niveau pratique on peut enseigner une « chose » sans avoir besoin de la désigner avec le mot le plus judicieux si on en reste sur le registre du faire, mais à un niveau plus théorique, ce serait une erreur que de juger cette querelle de mots sans importance.
L’analyse démontrant l’adéquation de l’avènement de la notion de compétence avec les volontés du marché du travail a largement été faite et est difficilement contestable. Parmi les nombreux extraits, citons celui-ci qui date des années 2000 : « Les employeurs ont reconnu en elles (les compétences clés européennes NDLR) des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s’adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution.(( Beatriz Pont et Patrick Werquin, « Nouvelles compétences : vraiment ? », L’observatoire de l’OCDE, Paris, avril 2001.))». La centration sur l’individu·e devenant le marqueur le l’idéologie libérale, la mise en avant des compétences n’est en rien une question pédagogique mais une question d’abord politique.
Une politique progressiste peut-elle aujourd’hui renoncer au « commun », au « pour tous et toutes », au partage de savoirs et connaissances qui permettront de faire société ? Pour les politiques libérales, c’est clair, la réponse est oui, il faut y renoncer car le système repose sur la mise en concurrence des individu·es entre elles·eux, à partir de leurs niveaux de compétence. Les « premier·ères de cordées » réussiront, les autres seront laissé·es pour compte, à passer leur temps à traverser la rue pour chercher du travail. À chacun·e selon ses moyens, qui sont, comme on le sait, corrélés aux catégories socioprofessionnelles des parents.
Pour ce qui concerne le SNEP-FSU, la réponse est inverse : une politique progressiste, incarnée dans un service public d’éducation, doit mettre en perspective des savoirs communs dont on estime l’acquisition nécessaire pour mieux comprendre le monde et pouvoir agir sur celui-ci. L’école existe justement pour aller à l’inverse de la pente historique qui conduit à l’individualisation, voire, on en a des exemples aujourd’hui, à l’assignation à résidence de chacun·e dans son propre monde. Toutes les disciplines ont cette fonction. On parle donc d’une socialisation par l’étude des savoirs disponibles. Si d’aventure l’EPS échappait à cette logique, on pourrait alors considérer qu’elle n’a pas de savoirs spécifiques, et donc qu’elle n’est pas une discipline, mais simplement une « activité » ou un temps scolaire.
Un service public d’éducation, doit mettre en perspective des savoirs communs dont on estime l’acquisition nécessaire pour mieux comprendre le monde et pouvoir agir sur celui-ci
L’EPS, en tant que bonne élève des politiques au pouvoir depuis si longtemps, oublie une chose cruciale : le ou les savoirs sont des biens publics. Ils sont connus, formalisés, donc échangeables, discutables, partageables… A contrario la compétence est un bien privé, de plus, relativement opaque puisque difficilement appréhendable dans son processus de construction.
Ironie de la chose, dans notre discipline, l’entrée du terme compétence dans les programmes n’a pas fait l’objet de grandes batailles pour une raison simple : tout le monde l’a rapproché plus ou moins implicitement du terme de savoir-faire !
La saveur des savoirs
Certains auteurs((Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre Paris : ESF, 2008 citant R. Barthes.)) ont relevé l’étymologie commune qui existe en « savoir » et « saveur ». Les savoirs ont une saveur dans le sens où ils sont une construction humaine, résultat d’une activité intense, parfois contradictoire ou conflictuelle, qui s’inscrit dans une histoire, souvent très longue… Mais pour accéder à cette saveur, il faut développer le goût ! C’est toute la problématique de l’École que d’identifier les savoirs à faire apprendre à tous et à toutes et mettre en œuvre une pédagogie pour que ça se réalise vraiment. Or, en EPS, cette première phase d’identification reste un processus malmené et à cette heure abandonnée par l’institution. Rappelons brièvement que si une trentaine d’années de notre histoire ont été consacrées à tenter de cerner ces « savoirs », concrétisés et synthétisés dans ce qui s’est appelé « compétences attendues((On voit au regard de ce que nous venons de développer, que ce n’est pas le moindre des paradoxes…))» , les derniers programmes disciplinaires laissent officiellement cette opération aux enseignant·es. C’est la fin, provisoire espérons-le, de l’idée d’une culture commune, de la revendication d’unité, de lisibilité, d’intelligibilité de l’EPS qui a pourtant été le leitmotiv de l’institution dans ces trente années. Cet abandon brusque, en rase campagne, est le signe d’un autre abandon politique, celui d’un service public dont la fonction est d’unir et partager plutôt que d’individualiser jusqu’à l’éclatement.
Le SNEP-FSU, en tant que première organisation professionnelle de l’EPS, a fait le choix de continuer à travailler à du « commun ». « Quels savoirs étudier en EPS » doit faire l’objet d’un travail continu et régulier.
Dans les programmes « alternatifs », nous avons écrit ceci :
« Les savoirs étudiés en EPS
Les savoirs principaux de l’EPS sont les Techniques propres au but et aux significations culturelle et sociale de chaque APSA, son cadre réglementaire ou symbolique, ses codes culturels et sociaux. Elles trouvent leurs origines dans la spécificité historique de l’activité humaine en jeu dans chacune d’elles, ses contradictions, ses inventions, ses évolutions. Ces savoirs intègrent des démarches, des attitudes ou comportements caractéristiques de chaque APSA, ou communes à certaines d’entre elles. »
Intégration contre séparatisme
L’activité humaine est complexe. Celle engagée dans une activité physique, sportive ou artistique a fortiori car elle engage la personne dans toutes ses dimensions. Mettre en mots cette activité, par exemple dans un texte officiel (programmes ou certification) a amené les auteur·es de ces textes à séparer les éléments les uns des autres. Cette distinction, nécessaire à un moment donné, pour mieux identifier ce qu’il y a à apprendre, peut devenir caricaturale lorsqu’elle se sclérose et devient dogmatique. L’exemple des CMS puis des AFL est aujourd’hui typique de cette logique. Il suffit d’ailleurs de voir comment certain·es se sont emparé·es de ces questions pour idéologiquement mettre ces éléments en concurrence, en poids et en pourcentage et nous orienter, par exemple, vers une éducation plus comportementale.
Pour notre part nous avons choisi, dans le cadre des programmes et des référentiels d’évaluation alternatifs, tout en distinguant les choses, de chercher l’intégration et non la séparation. Le paragraphe cité plus haut, présent dans notre préambule des programmes, a cette fonction. Si on lit bien, en 2 ou 3 phrases on cherche à relier ce qui a été disjoint ces dernières années : technique, signification, code, règlement, symboles, histoire, démarches, attitudes… C’est un choix politique, scientifique, pédagogique.
Retour sur les techniques
On le sait, pour se démarquer du technicisme sportif des années 60-70, la profession a cherché à se débarrasser d’un vocabulaire qui fait référence à cet univers. Aujourd’hui les termes technique, performance, compétition, pour ne prendre qu’eux, sont bannis du langage officiel de l’EPS, sauf pour les critiquer. Sur performance et compétition, nous avons écrit 2 numéros de la revue Contrepied, justement pour prendre à contre-pied cette critique, qui a réduit le sens de ces notions à leurs aspects et travers les plus insupportables. C’est sans doute la même chose pour la technique.
Or acquérir des techniques, quelle que soit la discipline et quelle que soit la nature de la technique, c’est avoir de nouveaux pouvoirs, c’est ouvrir des possibles. Concrètement c’est voir le monde différemment. C’est donc une route ouverte vers l’émancipation.
La question qui se pose alors, c’est celle du choix des techniques à apprendre.
Au vu du volume exponentiel des possibles, dans toutes les disciplines, choisir les plus pertinentes est sans doute la première opération à mener. Malheureusement cette opération est rarement explicite, et même rarement menée. Tout fonctionne plutôt sur la base d’approximation et de croyances. L’exemple récent de l’introduction du yoga (voir le dossier sur le site du centre EPS et Société) au lycée en est un exemple probant.
Toutes les techniques, même si elles drainent chacune leur part d’humanité, ne sont pas égales au plans symboliques, sociales, et en termes d’apprentissages. Il n’est un secret pour personne par exemple que le « crawl », en tant que technique de nage, est plus prometteuse pour la construction des futur·es nageur·euses que d’autres. On pourrait faire la même démonstration dans toutes les APSA. Il serait donc temps que l’institution assume ses responsabilités en organisant une mise à plat des savoirs en EPS pour construire un programme scolaire qui fasse référence. Mais avec les derniers programmes, elle a plutôt fait le choix inverse et de ne plus s’embêter avec l’EPS en déléguant au local ce travail.
Une construction dite « spiralaire »
Késako ? Pourquoi utiliser encore des termes barbares ? En fait, pas si barbare que ça. Le mot spiralaire évoque une spirale et c’est bien cette image qui colle à l’idée. Si nous prenons par exemple un élément technique comme le coup droit en tennis de table, ce n’est pas quelque chose que l’on acquiert à un moment « t » et ensuite on passe à autre chose. C’est quelque chose que l’on apprend, du débutant jusqu’au plus haut niveau sportif. Ensuite « apprendre le coup droit » ne signifie pas grand-chose au bout du compte et peut tomber, si l’on s’en tient aux formes extérieures et visibles, à ce qu’historiquement on a appelé le technicisme. Ne pas avoir une approche techniciste impose de comprendre la fonction de la technique, son sens, son rôle, sa fonction dans le jeu de tennis de table, mais surtout maitriser les différents registres sur lesquels jouer pour enseigner ou apprendre, sachant que ces registres sont en relation. Un exemple que tout le monde comprend. Travailler la puissance ou la force fait perdre, dans un premier temps, en précision. On progresse donc dans un registre et il faudra ensuite travailler un autre registre pour élever le niveau global. Si on travaille sur les ressentis, la concentration sur les sensations pour améliorer le « touché de balle », il y aura progrès sans doute, mais au détriment des aspects tactiques qui demandent aussi une mobilisation de l’attention. Il faudra un travail spécifique sur les problèmes tactiques, etc. Ça fonctionne effectivement comme une spirale. Pour élever un niveau, il faut petit à petit travailler tous les registres qui vont, chacun, améliorer l’apprentissage technique.
Acquérir des techniques, quelle que soit la discipline et quelle que soit la nature de la technique, c’est avoir de nouveaux pouvoirs, c’est ouvrir des possibles. Concrètement c’est voir le monde différemment. C’est donc une route ouverte vers l’émancipation.
C’est une des raisons qui nous ont amené à concevoir, non pas des programmes, mais un seul, pour toute la scolarité, dans lequel on note 3 ou 4 étapes de progressivité, en fonction non du niveau de classe mais du temps d’apprentissage dans l’APSA.
Selon nous, une EPS moderne ne consiste pas à travailler des choses différentes dans chaque cycle, au risque de papillonner, mais de travailler, de mieux en mieux, la même chose.
Conclusion provisoire
La question des savoirs, pour toutes les disciplines, est une question existentielle. Ne pas les définir ou mal les définir met en péril toute discipline scolaire. Les attaques contre les savoirs à l’École, quelles qu’en soient les raisons, sont des attaques contre l’émancipation des jeunes. Car savoir c’est pouvoir. Les disciplines, et la nôtre pour les registres qui sont les siens, sont des boîtes à outils pour s’émanciper. La critique de l’École, son fonctionnement actuel ou plutôt ses dysfonctionnements actuels, suite aux entreprises de destruction massives (comme la réforme du lycée de Macron), ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Certes, définir ces savoirs ne suffit pas, loin de là, pour faire réussir tous·tes les élèves. La pédagogie, c’est-à-dire les moyens mis en œuvre pour faire apprendre, est essentielle et déterminante. Mais en EPS, le « quoi apprendre », après 40 ans d’intégration à l’éducation nationale, reste un travail déterminant sur lequel l’institution a jeté l’éponge. On perçoit alors le risque de désintégration si les politiques publiques, poussées par la recherche d’économies, privatisent tout un pan de ses enseignements au profit d’une animation, pour seulement « bouger » et non plus apprendre.